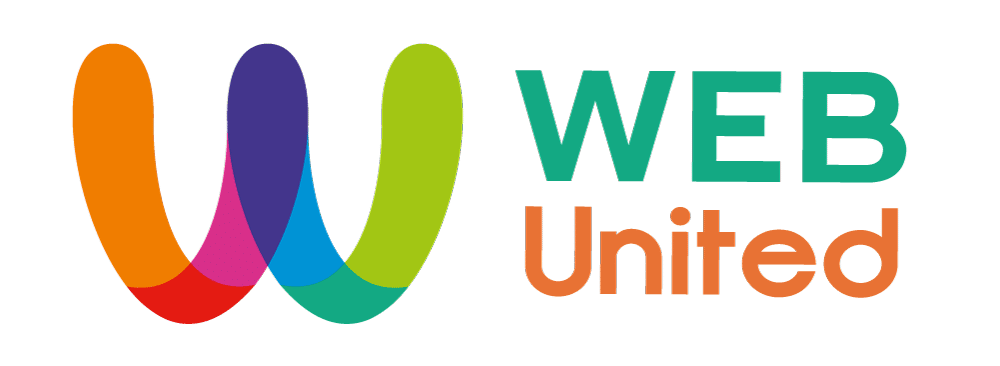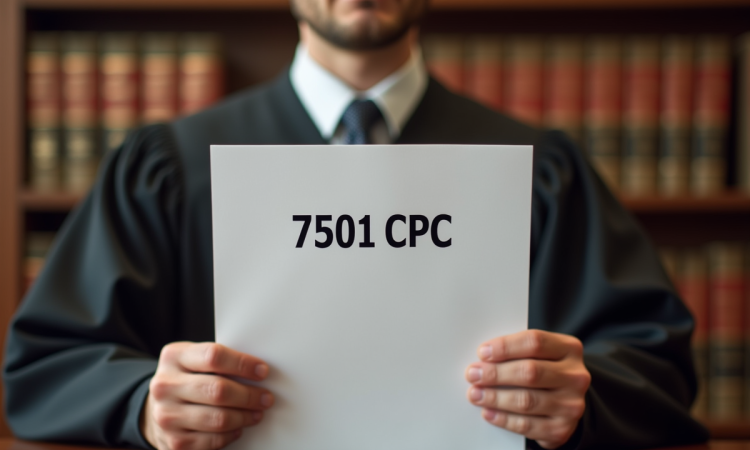
Les statistiques ne laissent aucune place au doute : depuis le 1er janvier 2020, le juge écarte d’office toute requête qui n’aurait pas été précédée d’une tentative de règlement amiable. L’article 750-1 du Code de procédure civile, loin d’être une formalité, impose dans certains cas une médiation, une conciliation ou une procédure participative avant toute saisine du tribunal.
Ignorer cette étape, c’est courir droit vers l’irrecevabilité. Les exceptions existent mais restent strictement encadrées, et les avocats jouent ici un rôle clé pour baliser le chemin, sécuriser l’action et éviter à leurs clients de se heurter à une fin de non-recevoir.
Plan de l'article
Pourquoi l’article 750-1 du Code de procédure civile a-t-il été instauré ?
Le législateur n’a rien laissé au hasard. L’article 750-1 du code de procédure civile s’inscrit dans une volonté claire : repenser la justice civile, en réponse à l’encombrement persistant des tribunaux. Le décret du 11 décembre 2019 a donc placé la résolution amiable au cœur du parcours judiciaire, misant sur l’échange avant la confrontation devant le juge. Le but ? Décongestionner les juridictions, accélérer le traitement des litiges courants et encourager les citoyens à s’emparer eux-mêmes de leurs différends.
Deux axes structurent cette réforme. D’abord, la promotion des modes alternatifs de règlement des différends : médiation, conciliation, procédure participative. Ensuite, la responsabilisation des parties, qui deviennent actrices de la gestion du conflit. Le juge n’intervient désormais qu’en ultime recours, une logique qui traverse tout le code de procédure civil et s’aligne sur les évolutions du droit processuel.
Impossible d’ignorer le contexte : plus de 3 millions d’affaires civiles chaque année. Le système judiciaire ne pouvait plus absorber ce volume sans compromis sur la qualité. Le recours aux modes alternatifs s’impose ainsi comme une solution concrète à la saturation chronique. Si la conciliation existe depuis 1978, elle n’avait jamais réellement convaincu. Le décret de 2019 vient corriger le tir en rendant la tentative amiable incontournable, et redonne au dialogue tout son poids dans la résolution des litiges.
Quels litiges sont concernés par la médiation préalable obligatoire ?
La tentative préalable de règlement amiable, exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile, vise une catégorie bien identifiée de litiges devant le tribunal judiciaire. Cette obligation s’applique aux différends dont le montant ne dépasse pas 5 000 euros, mais aussi à certains domaines précisément listés par la loi, quelle que soit la somme en jeu.
Avant d’engager le juge, il faut donc, sauf rares exceptions, passer par une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Voici les principaux types de conflits concernés :
- troubles de voisinage : ces litiges, souvent source de tensions locales, sont désormais soumis à la médiation en priorité ;
- litiges relatifs à un contrat de bail d’habitation ;
- petits différends de consommation ou impayés de charges de copropriété.
Quelques contentieux échappent à la règle : ceux touchant à l’ordre public, à l’état des personnes ou à l’urgence sont exclus de l’obligation. De plus, la tentative amiable saute si un motif légitime est prouvé, indisponibilité concrète des dispositifs, danger, ou impossibilité manifeste de dialoguer.
Le code de procédure civile encadre cette exigence avec rigueur : la résolution amiable du litige devient une étape imposée, structurante, qui entend transformer la façon d’aborder le procès civil.
Étapes clés de la procédure : comment respecter l’obligation de tentative amiable
Impossible d’accéder au juge sans avoir tenté de régler le différend à l’amiable. Trois options s’offrent aux parties : solliciter un conciliateur de justice, recourir à un tiers indépendant dans le cadre d’une médiation, ou, moins fréquemment, opter pour une procédure participative pilotée par des avocats. Toutes ces voies répondent aux exigences du code de procédure civile.
Le choix dépend du conflit et de la volonté des parties. La conciliation, souvent la plus rapide, met en jeu un conciliateur désigné par le tribunal, généralement bénévole. La médiation s’appuie sur un professionnel formé à l’écoute et à la résolution de conflits. Pour la procédure participative, une convention écrite formalise l’engagement réciproque des parties et de leurs conseils à chercher un accord.
La preuve de la tentative de résolution amiable est déterminante : il convient de conserver tout échange, convocation ou attestation du conciliateur, ou encore un procès-verbal de non-conciliation. Ce document, joint à l’assignation ou à la requête, atteste du sérieux de la démarche.
Pour ne rien laisser au hasard, voici les étapes à suivre :
- Prendre rendez-vous avec un conciliateur de justice ou un médiateur agréé.
- Présenter les faits et les positions de chaque partie de façon claire.
- Obtenir un document officiel qui atteste du résultat de la tentative amiable.
La moindre négligence peut coûter cher : ignorer cette procédure expose à un refus net du juge d’examiner le dossier, sauf si la loi prévoit une exception. La tentative amiable façonne désormais l’agenda et la stratégie de tout dossier civil relevant du 750-1 CPC.
Sanctions, rôle de l’avocat et conseils pratiques pour éviter les écueils
Le 750-1 CPC ne laisse place à aucune ambiguïté : en cas d’oubli, l’irrecevabilité frappe le dossier, et le tribunal refuse d’aller plus loin. Seule une exception reconnue peut permettre d’échapper à cette issue. Il faut donc pouvoir prouver, document à l’appui, que la tentative amiable a bien été réalisée.
L’avocat ne se limite pas à rédiger une assignation. Il anticipe les obstacles, identifie les cas où une dispense est possible, urgence, motif légitime, absence ou indisponibilité du conciliateur, ou litige expressément exclu par décret. Son accompagnement garantit la régularité de la procédure et sécurise la saisine du juge.
Pour naviguer sans accroc dans ce cadre procédural, quelques réflexes sont à adopter :
- Sollicitez un professionnel du droit dès le début pour vérifier si l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à votre cas.
- Gardez tous les justificatifs relatifs à la tentative amiable : convocations, attestations, procès-verbaux.
- Vérifiez la disponibilité réelle des modes alternatifs de règlement dans votre secteur ; la jurisprudence admet une dispense en cas d’indisponibilité avérée.
La précision et la rigueur sont vos meilleures alliées : devant un tribunal qui applique strictement le code de procédure, le moindre faux pas bloque l’action dès le seuil. L’avocat, par sa maîtrise, protège ses clients d’une fin de non-recevoir qui peut, en un instant, clore le débat avant même qu’il n’ait débuté.
La procédure civile s’est dotée d’un filtre redoutablement efficace. Désormais, celui qui entend saisir la justice doit d’abord avoir tenté le dialogue, et pouvoir en apporter la preuve. Le tribunal n’attend pas ; il tranche, parfois sans même examiner le fond. À chacun d’intégrer cette nouvelle donne, sous peine de voir la porte du prétoire rester close.