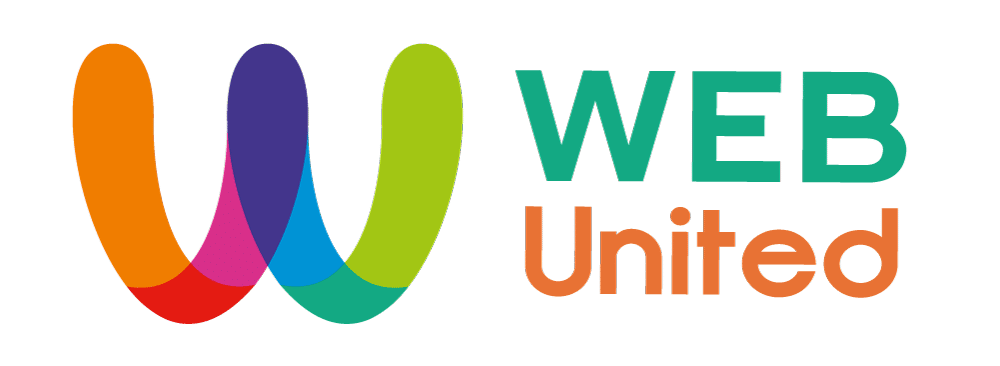Depuis quelques années, la Chine s’impose de plus en plus sur la scène mondiale. Elle fait aujourd’hui partie des puissances mondiales, ce qui étonne plus d’un en raison de la rapidité de son essor. Beaucoup se demandent donc comment cela s’est-il produit. À travers cet article, nous répondrons à cette question.
Plan de l'article
L’augmentation des exportations et de la productivité
La Chine s’est hissée parmi les géants de la planète avant tout grâce à la croissance fulgurante de ses exportations et à la montée en puissance de sa productivité. Son entrée à l’Organisation mondiale du commerce en 2001 a marqué un tournant : les échanges commerciaux se sont démultipliés, ouvrant grand les portes du marché international.
Impossible de faire abstraction du rôle de « fabrique du globe » qu’a endossé le pays. Des jouets aux vêtements, en passant par les appareils électroniques dernier cri, la Chine assemble, produit, expédie à une cadence impressionnante. Sur les chaînes d’assemblage de Shenzhen, des iPhone voient le jour à un rythme qui ferait pâlir d’envie bien des concurrents. Ce ne sont pas seulement des produits du quotidien, mais aussi des équipements industriels et des moyens de transport qui sortent de ses usines et inondent les rayons du monde entier.
Pour soutenir cette dynamique, la Chine n’a pas lésiné sur les investissements. Elle a modernisé ses infrastructures afin d’optimiser la qualité de sa production et l’efficacité de ses échanges. Voici les domaines dans lesquels ces efforts ont été particulièrement visibles :
- déploiement de machines de fabrication sophistiquées et amélioration des conditions de travail dans les usines ;
- développement des réseaux de télécommunication : satellites, mobile, internet ;
- construction et modernisation des infrastructures de transport : aéroports, autoroutes, voies ferrées ;
- investissements massifs dans l’énergie, qu’il s’agisse de barrages hydroélectriques ou de centrales nucléaires.
Du côté de la main-d’œuvre, le pays forme chaque année une armée de près de 500 000 ingénieurs grâce à ses quelque 300 universités. Entre 1980 et 2010, la population en âge de travailler a bondi, passant de 360 à 914 millions de personnes âgées de 15 à 59 ans. Ce réservoir humain a alimenté la croissance industrielle et permis à la Chine d’accélérer son développement.
Les partenariats BtoB
L’ascension de la Chine s’explique aussi par sa stratégie de partenariats internationaux. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud figurent parmi ses principaux interlocuteurs, tandis que ses investissements s’étendent dans les pays émergents, en particulier en Afrique. En multipliant les accords et les projets communs, la Chine accède à de nouvelles ressources, notamment des matières premières indispensables à ses industries. Ce jeu d’alliances et d’investissements permet aussi au pays d’obtenir des facilités d’importation, renforçant ainsi son autonomie et sa capacité à produire à grande échelle.
La puissance militaire de la Chine
Sur le terrain militaire, la Chine impose le respect. Elle dispose de la plus grande armée du monde, avec près de 2 millions de soldats actifs, épaulés par 510 000 réservistes. Le budget de la défense atteint 250,2 milliards de dollars. Avec un arsenal nucléaire de 350 bombes et un score PowerIndex de 0,0511, Pékin occupe la troisième place mondiale en matière de puissance militaire. Sans oublier le soutien de partenaires stratégiques : dans l’hypothèse d’un conflit, la Chine peut s’appuyer sur des alliés solides prêts à peser dans la balance des rapports de force internationaux.
Les autres leviers de l’influence chinoise
L’ascension rapide de la Chine comme principal pôle industriel mondial résulte aussi d’une combinaison de facteurs. Il est utile de les rappeler :
- accès à une grande variété de ressources naturelles sur son territoire ;
- main-d’œuvre à la fois qualifiée, compétente et dont le coût reste attractif ;
- marché intérieur colossal, fort de plus d’1,5 milliard de personnes ;
- création de zones économiques spéciales qui dynamisent l’innovation et l’exportation.
Le régime communiste offre également au pays une stabilité socio-politique rarement prise en défaut. Cette atmosphère apaisée sur le plan intérieur facilite la réalisation de projets à long terme sans crainte de bouleversements majeurs. De plus, la politique d’autosuffisance, largement encouragée, pousse la population à se focaliser sur le développement national, ce qui alimente encore la machine économique.
La diplomatie économique chinoise : investissements et prêts à l’étranger
Au-delà de sa géographie, la Chine a mis sur pied une stratégie diplomatique taillée pour élargir son empreinte économique. Cette diplomatie économique s’incarne dans des investissements massifs au sein des pays émergents et en développement, mais aussi dans des prêts proposés à des taux avantageux.
Dans cette perspective, Pékin a fondé plusieurs institutions financières telles que la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) et la Nouvelle banque de développement. Grâce à ces outils, elle finance des chantiers d’envergure : routes, lignes ferroviaires, ports… Les investissements directs à l’étranger s’envolent, renforçant la présence chinoise sur tous les continents.
Ce modèle suscite néanmoins des réserves. Certains pays bénéficiaires se voient imposer des conditions strictes : obligation de faire appel à des entreprises chinoises pour la réalisation des travaux, ou acceptation de clauses qui privilégient clairement les intérêts de Pékin.
Mais malgré les critiques, la Chine gagne du terrain. Sa stratégie a déjà permis d’élargir sa sphère d’influence bien au-delà de ses frontières. Selon de nombreux analystes, elle pourrait bientôt dépasser l’influence américaine en Afrique, où elle mène une véritable offensive économique.
La Nouvelle Route de la Soie et son impact géopolitique
Lancée en 2013, la Nouvelle Route de la Soie, ou Initiative Belt and Road, marque l’ambition de la Chine de recréer un réseau commercial vaste, reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe via des corridors terrestres et maritimes.
Pour mettre en œuvre ce projet, la Chine investit dans des infrastructures majeures : routes, ports, chemins de fer. L’objectif ? Fluidifier les échanges, sécuriser l’approvisionnement en matières premières, mais aussi affirmer sa présence sur la scène internationale.
Ce plan d’expansion inquiète certains observateurs, qui y voient la volonté de Pékin de s’imposer comme puissance dominante sur l’échiquier régional. Il arrive que des projets se développent sans réelle concertation avec les gouvernements locaux, ou en privilégiant systématiquement les entreprises chinoises aux acteurs locaux.
De telles pratiques peuvent accentuer les déséquilibres commerciaux et rendre certains partenaires de plus en plus dépendants de la Chine.
Reste que l’Initiative Belt and Road est déjà en train de redessiner la carte des relations internationales, rapprochant l’est et l’ouest et propulsant les échanges à un niveau inédit. Impossible aujourd’hui d’ignorer cette nouvelle dynamique : le visage du commerce mondial s’en trouve transformé, et les équilibres de puissance sont en pleine mutation. Qui sait jusqu’où la Chine continuera de pousser ses pions ?