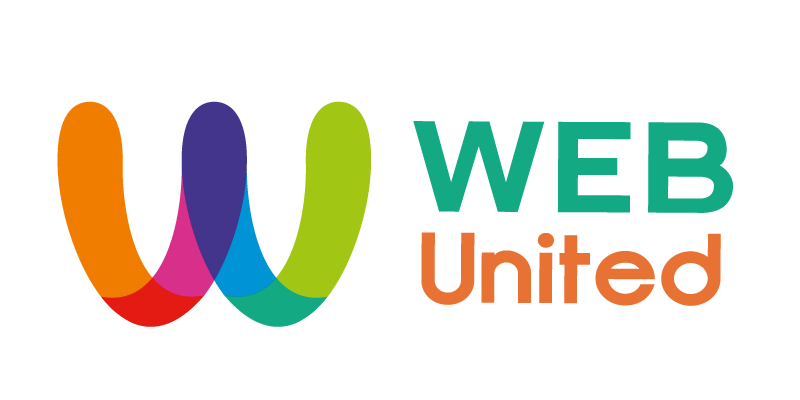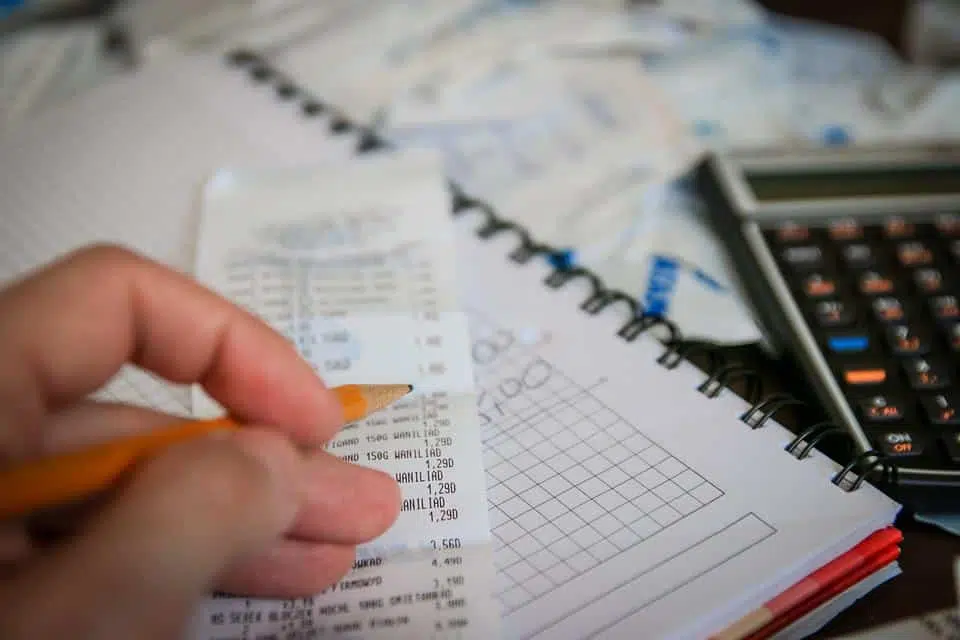En 1926, la Cour suprême des États-Unis a validé le droit des municipalités à séparer strictement les usages du sol, rendant possible l’exclusion de certains types de logements dans de vastes portions des villes. Cette décision, souvent invoquée mais rarement remise en cause, a façonné la croissance urbaine sur l’ensemble du territoire américain.
Portland, pourtant saluée pour ses choix progressistes, illustre à quel point ces règles continuent d’orienter la forme des quartiers, parfois au détriment de la mixité sociale. Les mécanismes du zonage, loin d’être universels, se heurtent à d’autres modèles urbains, notamment en France.
Aux origines du zonage urbain : comprendre les racines américaines
Les villes américaines, à la charnière du xixe siècle, dessinent un nouveau paysage. Chicago, Boston, Cleveland, Cincinnati : chacune cherche à absorber un afflux de population inédit, résultat de l’industrialisation et de l’exode rural. Au cœur de cette effervescence, le désordre inquiète urbanistes et pionniers de la sociologie urbaine. Réguler, organiser, structurer : le zonage devient alors la réponse privilégiée pour contrôler l’expansion et donner forme à la ville moderne. Séparer les usages, instaurer des frontières précises entre zones résidentielles, commerciales et industrielles, voilà la promesse d’une ville plus lisible, plus fonctionnelle.
La planification urbaine prend alors des allures de discipline rationnelle, presque scientifique. Les municipalités imposent des règles strictes qui dessinent l’espace, hiérarchisent les quartiers, tracent des lignes de démarcation entre centre et périphérie. Les centres-villes se consacrent aux affaires, tandis que les banlieues se spécialisent dans l’habitat. La ville devient un objet d’étude pour la géographie et la sociologie : Jean-Bernard Racine, entre autres, décrypte la structure interne des villes américaines et souligne les effets parfois pervers de cette organisation.
Voici, de façon concrète, ce que produit ce modèle :
- La mixité sociale se dilue : le zonage enferme les populations dans des espaces distincts, limitant la rencontre et la diversité.
- La mixité fonctionnelle disparaît, laissant la place à des quartiers aux fonctions exclusives, parfois monotones.
- Un nouveau type de ville émerge, segmenté, qui porte en lui des tensions inédites entre groupes sociaux et activités.
Ce schéma, progressivement, s’impose sur l’ensemble du territoire. Il inspire urbanistes, divise les architectes, et façonne la vie quotidienne. La banlieue devient l’emblème d’un mode de vie, mais elle cristallise aussi une séparation insidieuse, ancrée dans les textes réglementaires et visible dans la géographie même des villes américaines.
Pourquoi le zonage a-t-il façonné l’identité des villes américaines ?
Tout l’urbanisme américain s’est bâti sur ces lignes de fracture, parfois visibles, souvent enfouies dans le tissu urbain. Le zonage trace ses limites : ici les habitations, là les bureaux, plus loin les usines, chacun à sa place. Ce découpage influence profondément la mixité sociale : le logement abordable se retrouve rejeté à la périphérie, loin des opportunités économiques et des services. Quant à la mixité fonctionnelle, elle s’efface devant une organisation où chaque espace se voit assigner une vocation unique.
Dans les grandes villes, ces choix urbains compliquent la mobilité. Les distances s’étirent, les réseaux de transports peinent à raccorder des quartiers conçus pour la voiture et la séparation des fonctions. À Los Angeles, Houston ou Atlanta, les habitants en font l’expérience quotidienne : trajets interminables, dépendance à l’automobile, isolement des communautés. Ce modèle fragmente le tissu social, affaiblit la sécurité urbaine et nourrit un climat de méfiance entre quartiers.
Pour mieux comprendre ces effets, il suffit d’observer ce que le zonage engendre dans la vie urbaine :
- La ville se morcelle, s’organise autour de réseaux de transport et de barrières sociales parfois infranchissables.
- La mixité reste à l’état de promesse, étouffée par une planification qui favorise la séparation plutôt que l’hybridation.
- Les politiques urbaines s’efforcent d’amender ces déséquilibres, mais l’héritage du zonage pèse lourd et résiste au changement.
La planification urbaine made in USA, modelée par le droit et l’histoire, continue de dessiner la répartition des ressources et des inégalités. Elle influence chaque jour la manière dont se vivent les solidarités, les déplacements, les espoirs et les frustrations dans la ville américaine.
Portland, laboratoire d’urbanisme : promesses et paradoxes d’une ville modèle
À Portland, on tente de déjouer les règles du jeu. La planification urbaine s’incarne dans une politique ambitieuse : limiter l’étalement, sauvegarder les terres agricoles, contenir la poussée périphérique qui ronge tant d’autres métropoles. Ici, la ville durable ne se réduit pas à un mot-valise, c’est un véritable cap poursuivi par les élus et les habitants. Le périmètre d’expansion urbaine, ou « Urban Growth Boundary », marque une rupture avec l’étalement sans fin qui caractérise tant de villes américaines.
À Portland, la participation citoyenne n’est pas une formalité. On consulte, on débat, on expérimente. Les conseils de quartier jouent un rôle réel, les habitants participent à la fabrique de la ville. Les transports collectifs, la pratique du vélo, les parcs et espaces verts sont pensés comme des choix de société. Même la technologie, loin d’être gadget, sert à rendre la ville plus accessible, plus connectée à ses citoyens.
Mais les tensions ne disparaissent pas pour autant. Les prix flambent, la gentrification gagne du terrain, poussant les plus modestes en dehors de la ville verte. Ce laboratoire d’urbanisme révèle ses propres contradictions : la ville végétale, modèle écologique et connecté, reste parfois hors de portée de ceux qui en auraient le plus besoin. La référence à la smart city ne gomme ni les inégalités, ni les limites du système. Portland expose autant qu’elle éclaire les défis des villes américaines, même sous un vernis d’innovation et de concertation.
L’américanisation des villes françaises : quelles leçons tirer du modèle américain ?
La politique de la ville en France, parfois fascinée, souvent prudente, observe les expérimentations américaines avec un mélange d’intérêt et de distance. Les discussions autour de la gouvernance urbaine et le rôle des collectivités territoriales s’inspirent en partie de la liberté laissée aux métropoles américaines. Mais, ici, le Grand Paris symbolise une autre tension : celle d’un projet métropolitain surveillé de près par un État central, soucieux de garantir l’équilibre entre territoires via la péréquation.
Entre admiration et réserve, la France regarde le modèle américain sans jamais l’adopter pleinement. Les quartiers prioritaires, dispositifs de politique publique, font écho à la discrimination positive américaine, bien que les approches diffèrent. L’Anru, moteur de la transformation urbaine, s’attache à changer le visage des quartiers, mais l’intégration sociale ne suit pas toujours. Le zonage, qui structure l’espace, peut aussi accentuer les difficultés à instaurer une véritable mixité fonctionnelle et sociale, problématiques déjà pointées dans la littérature urbaine outre-Atlantique.
Dans ce contexte, le dialogue entre associations, entreprises et pouvoirs publics prend une nouvelle dimension. Ces acteurs interrogent le sens profond du projet urbain, sa capacité à s’ouvrir à la culture, à l’art, mais surtout à ne pas reproduire les fractures héritées du passé. La ville française, face aux impasses du modèle américain, doit réinventer sa manière de penser l’espace, d’écouter ses marges, et de faire émerger des alternatives qui ne se contentent pas d’importer ou de rejeter, mais qui misent sur la singularité de chaque territoire.
Ce qui se joue dans le zonage, ce n’est pas seulement une affaire de plans ou de règlements : c’est la possibilité de faire cohabiter, dans la ville, des histoires, des populations, des usages qui trop longtemps, de part et d’autre de l’Atlantique, ont appris à vivre séparés. Laissons ouverts les chemins qui relient, et pas seulement ceux qui séparent.