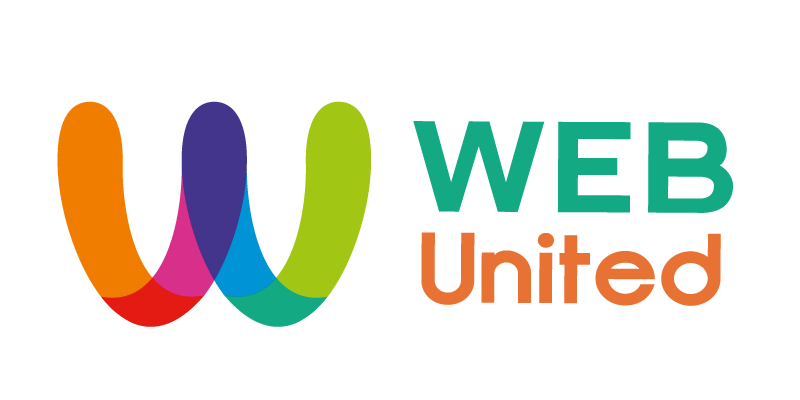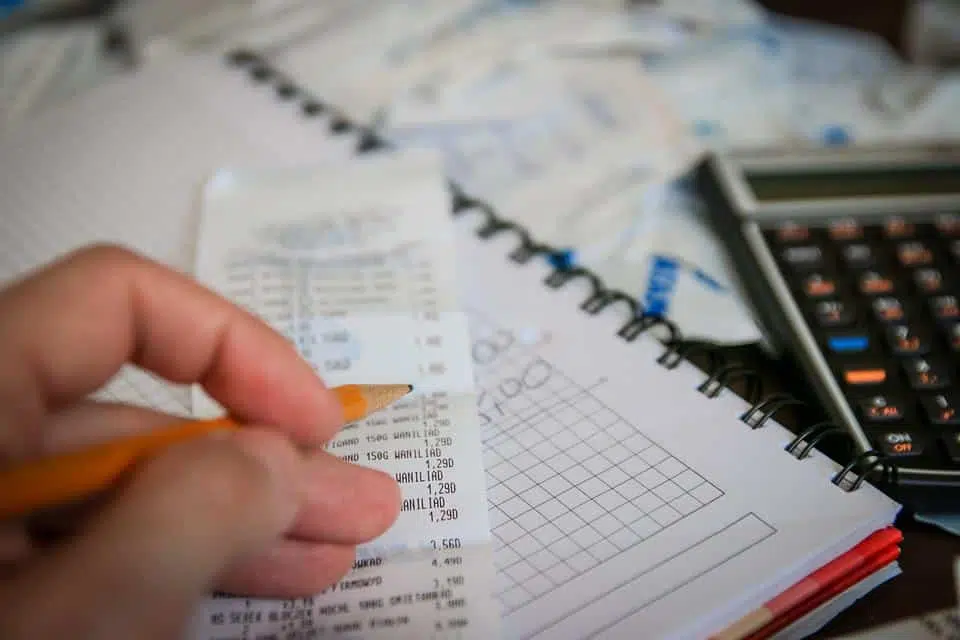Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing débute quelques semaines après la première crise pétrolière et s’achève dans un contexte d’instabilité économique mondiale. Les lois de réforme sociale, votées au forceps et souvent contestées, coïncident avec une modernisation accélérée de la société française, sans précédent depuis la Libération.
À l’échelle européenne, la France joue un rôle moteur dans la construction communautaire, tandis que les institutions de la Cinquième République subissent des tensions internes inédites. L’expérience giscardienne marque une période de transition, entre héritage gaullien et ouverture vers de nouveaux équilibres politiques.
Valéry Giscard d’Estaing : qui était-il et quelle place occupe-t-il dans la Cinquième République ?
Polytechnicien, haut fonctionnaire, Valéry Giscard d’Estaing incarne l’ascension d’une nouvelle génération d’élites administratives qui prennent le relais des gaullistes à la tête du pays. Lorsqu’il accède à la présidence de la République française en 1974, il brise la tradition en s’imposant comme le plus jeune chef de l’État depuis Louis-Napoléon Bonaparte. Ce n’est pas qu’une question d’âge : sa victoire, arrachée à François Mitterrand lors d’une élection présidentielle particulièrement disputée, impose une rupture de style et d’ambition.
La modernisation devient son mot d’ordre. Giscard d’Estaing s’attelle à réconcilier l’héritage républicain avec l’urgence d’adapter la France à un monde en mutation. Cette volonté se reflète dans sa relation avec la Constitution, l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Il confie Matignon à Jacques Chirac, puis à Raymond Barre, cherchant à renforcer la stabilité de l’État et à donner une direction claire à l’action gouvernementale.
Giscard d’Estaing se distingue dans la vie politique française par son rapport exigeant au droit constitutionnel et son désir de transformer la fonction présidentielle. Il n’hésite pas à bousculer l’équilibre des pouvoirs traditionnels pour donner à l’exécutif une impulsion nouvelle. Sa marque : un style direct, réformateur, qui inscrit durablement la présidence dans une logique d’adaptation et d’innovation.
Les grandes réformes et orientations politiques du septennat VGE
Sous l’impulsion de Valéry Giscard d’Estaing, une vague de réformes sociétales secoue la vie politique française. Dès son arrivée à l’Élysée, il impose un tempo inédit au gouvernement et au Conseil des ministres. La majorité fixée à 18 ans bouleverse la donne : soudain, une nouvelle génération entre dans l’arène citoyenne, modifiant le paysage électoral et la composition de l’Assemblée.
D’autres mesures, tout aussi décisives, voient le jour. La loi sur l’IVG, portée par Simone Veil, affronte une opposition farouche mais finit par être adoptée. Ce texte, qui rend l’interruption volontaire de grossesse légale, s’inscrit dans la continuité des principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, affirmant le primat du droit individuel sur les normes sociales du temps.
La modernisation touche aussi les institutions. Le Conseil des ministres s’ouvre à de nouveaux profils, le dialogue avec la jeunesse gagne en intensité, les droits des femmes progressent. Autant de signaux d’une République qui cherche à coller aux réalités contemporaines.
Voici les grands chantiers qui ont marqué ce septennat :
- Majorité abaissée à 18 ans : élargissement du corps électoral
- Lois sur l’IVG : affirmation des droits des femmes
- Renforcement du dialogue social et institutionnel
Avec des collaborateurs tels que Jacques Chirac ou Raymond Barre, Giscard d’Estaing façonne une France à la fois fidèle à la Déclaration des Droits de l’Homme et lucide sur les évolutions à mener. Sa politique ne se contente pas de gérer l’existant : elle cherche à provoquer le changement, tout en s’appuyant sur les fondements républicains.
Comment la présidence giscardienne a-t-elle répondu aux défis économiques et sociaux des années 1970 ?
L’arrivée de Giscard d’Estaing à l’Élysée coïncide avec la grande onde de choc de la crise économique de 1973. La France, frappée par le ralentissement mondial, peine à contenir la montée du chômage et l’inflation. Face à cette tempête, le président, épaulé par Raymond Barre d’abord aux Finances puis à Matignon, choisit la rigueur : la dépense publique est maîtrisée, la dette contrôlée, l’État tente de préserver la confiance des investisseurs.
Ce choix s’oppose à la gestion keynésienne des décennies précédentes. Le gouvernement limite l’indexation des salaires, lance des plans pour soutenir l’emploi et l’industrie, mais refuse de sombrer dans la surenchère budgétaire. La mission est claire : défendre le pouvoir d’achat sans laisser filer les prix. La marge de manœuvre reste étroite, chaque arbitrage est surveillé, discuté, contesté.
Mais le social n’est pas sacrifié. Plusieurs mesures concrètes sont adoptées : création de l’Allocation adulte handicapé, élargissement de la Sécurité sociale, relance de la construction de logements sociaux. Le dialogue social s’institutionnalise, malgré des tensions persistantes. La nomination de Raymond Barre à Matignon témoigne de la volonté de conjuguer expertise économique et autorité politique.
Trois axes résument la réponse giscardienne aux défis de l’époque :
- Réponse à la crise économique par la rigueur budgétaire
- Soutien à l’emploi et à l’industrie
- Renforcement du dialogue social
Entre orthodoxie économique et initiatives sociales, la politique giscardienne tente d’inventer une voie française, dans une République confrontée à la réalité d’un monde en mutation rapide.
Héritage de VGE : quelles traces dans la société française et la construction européenne ?
L’empreinte de Valéry Giscard d’Estaing ne s’efface pas des mémoires institutionnelles et collectives. Président élu au suffrage universel, il a transformé le rapport des citoyens à la vie politique française. L’abaissement de la majorité à 18 ans, la promotion de nouveaux droits, la consolidation du suffrage universel direct pour la présidentielle : autant de changements qui s’enracinent durablement dans la période giscardienne.
Son rôle dans la construction européenne va au-delà du symbole. Giscard d’Estaing engage la France dans une dynamique de coopération renforcée avec l’Allemagne, donne une impulsion décisive à la convergence monétaire et prépare le terrain des futurs traités européens. La création du Conseil européen en 1974, point de départ d’un dialogue renouvelé entre chefs d’État, structure une Europe politique, prémisse du Traité de Maastricht. La France, à cette époque, assume pleinement son statut de moteur de l’union européenne, avec une voix forte et singulière.
Dans la société française, le souvenir d’un président soucieux d’émancipation s’estompe peu. Majorité à 18 ans, nouveaux droits, esprit réformateur : autant de repères issus de cette période. Le droit constitutionnel s’enrichit, l’équilibre des pouvoirs évolue, sans jamais compromettre la stabilité du régime. L’héritage de Giscard d’Estaing se lit dans la persistance d’une ambition réformatrice, dans la conviction que la France ne peut se penser sans l’Europe, et que la République se doit d’être en mouvement.
En filigrane, une certitude : chaque génération se confronte à ses propres défis, mais certaines périodes, à l’image du septennat giscardien, laissent une marque indélébile sur le visage d’un pays.